"La ferme des poudres et salpêtres création et approvisionnement en poudre en France (1664 - 1765)" par Frédéric Naulet
Copyright (c) 1998-2004 Institut de Stratégie Comparée / www.stratisc.org
III - Une conservation problématique :
2 - Des magasins à poudre souvent inadaptés :
"Au-delà de ces avis contradictoires, tous étaient d'accord pour reconnaître que la cause principale de la dégradation de la poudre était l'état des magasins, à commencer par celui de Caen, où un radoub était nécessaire tous les deux ans. Ceux de Bergues n'étaient pas meilleurs.
"Il n'y a à Bergues que de petits magasins qui sont très mauvais et qui d'ailleurs ne suffisent pas pour serrer les munitions et attirails d'artillerie [82].
"Le mémoire du comte de Thomassin [83], de 1752, était édifiant [84]. Selon lui, les tours et les portes, toujours trop humides, ne devaient pas servir de magasins à poudre or cela était fréquemment le cas. En 1764, rien que pour les six places de la direction de La Fère, quatre avaient des magasins situés dans ce genre de lieux [85]. Même une ville comme Strasbourg, disposant pourtant de magasins aménagés dans les nouveaux bastions, connaissait ce genre de problèmes et depuis longtemps. En 1690, Louvois avait déjà interdit d'utiliser le souterrain de la porte de Pierre car on ne devait" se servir des lieux humides pour resserrer de la poudre que dans une extrême nécessité [86]". Vœux pieux tant le royaume manquait de magasins. Sept ans plus tard, 10 000 livres de poudre y étaient encore entreposées, même si ce souterrain pouvait en contenir 15.000 [87]. Ces lieux n'étaient pas les seuls à poser des problèmes.
"L'on observe encore que les magasins à poudre, ou autres bâtiments à cet usage ne sont pas tous parfaitement en bon état, il manque aux uns des planches, aux autres des portes, des fenêtres et des contrevents, à d'autres sont des pièces de bois bruttes et sinueuses qui servent de chantier [88]".
Non seulement ces conditions pouvaient entraîner l'humidité du magasin mais même l'état des planchers pouvait compromettre l'équilibre de certains empilements de barils. Le mur offrait parfois un appui salutaire qui n'empêchait toutefois pas certaines chutes. Plus curieux, il arrivait à certains barils de... flotter. Entre 1703 et 1706, le magasin d'Hesdin fut inondé à deux reprises. Les poudres étaient tellement gâtées que le fermier refusa de les radouber si on ne lui accordait pas au moins 10% de déchet, ce qui, compte tenu des circonstances, fut obtenu sans problème [89]. Dans ce cas, au moins connaissait-on l'état réel des poudres car il arrivait parfois que des magasins ne soient pas ouverts pendant plusieurs années comme au château de Lichtenberg . Certes, la place n'était pas d'une importance majeure mais, en 1706, les trois quarts des poudres, soit 9.600 livres, étaient hors d'usage. Le garde-magasin, âgé de 85 ans, n'avait pas ouvert la salle depuis quatre ans [90].
La situation des bâtiments pouvait aussi poser des problèmes. A Bapaume, le magasin (pouvant contenir 70.000 livres de poudre) était contigu à un terrain où certains habitants venaient s'exercer au tir à l'arc. Selon Saint-Périer [91], ces derniers n'hésitaient pas à y boire et à y fumer, faisant courir un risque évident au contenu du bâtiment. Plus grave, les 6 magasins de Perpignan étaient tellement proches les uns des autres que si la foudre venait par malheur à en frapper un, tous les autres étaient irrémédiablement condamnés. Le plus petit ne contenait que 9.000 livres mais le plus grand en renfermait 50.000 [92].
Pour Thomassin, la construction de grands magasins était une erreur car ils étaient trop exposés et difficiles à gérer. En cas de siège, il est aisé d'imaginer l'effet que pouvait produire une seule bombe tombant sur un bâtiment contenant 150.000 livres de poudre. En 1691, la ville de Nice avait dû se rendre à Catinat après que deux magasins à poudre de 80.000 livres et de 20.000 livres aient sauté. La description des lieux après l'explosion laissée par le maréchal est saisissante.
"C'est un objet horrible que ce chasteau, tous les logemens sont ruinez, c'est un débris général mêlés de morts où l'infection commence à estre fort grande (...). L'on ne peut pas oster de l'esprit de Monsieur le comte de Frossac et de beaucoup d'officiers que ce malheur leur est arrivé par une trahison, nous autres avons veu sensiblement que c'est l'effet de nos bombes [93]. "
Comparés aux magasins des principales places fortes françaises, ceux de Nice étaient tout petits. Sur les sept que comptaient la ville et la citadelle de Strasbourg, le plus exigu, celui de l'hôpital royal, pouvait contenir 112.800 livres. Quatre avaient une capacité de 122.400 livres et il était possible d'en entreposer 165.600 dans celui d'un bastion et jusqu'à 259.200 livres dans le magasin neuf. Même si ce dernier faisait parti des plus grands du royaume, il en existait de plus vastes comme les deux de Neuf-Brisach, pouvant contenir chacun 300.000 livres ou les trois de Metz avec une capacité de 500.000 livres chacun [94]. Or, Thomassin considérait qu'il ne fallait pas dépasser les 139.000 livres.
Il proposait même un nouveau modèle, capable de résister aux bombes car protégé par une maçonnerie de ciment et une terrasse en terre [95]. Les finances ne permettant pas d'engager de grandes dépenses[96], ce projet fur écarté et d'Angervilliers proposa d'établir des entresols dans les magasins existants. L'idée du secrétaire d'État à la guerre ne trouva guère d'écho auprès des officiers d'artillerie, ces derniers craignant une fragilisation excessive des bâtiments.
Un autre élément devait contribuer au bon état des poudres : leur radoub assuré par l'entrepreneur des poudres et salpêtres. Son marché lui imposait une certaine quantité à remettre en état, celle-ci pouvant évoluer selon les circonstances. Le radoub pouvait être de deux ordres :
- soit, il s'agissait de ressécher les poudres, c'est-à-dire les sortir des barils et en ôter l'humidité, souvent inévitable après un séjour dans les magasins. L'opération était relativement simple et ne coûtait pas grand chose, si ce n'est le prix de la main-d'oeuvre.
- soit, il fallait rebattre la poudre. Dans ce cas, la qualité de celle-ci s'étant nettement détériorée, il fallait la ramener dans un moulin, la remettre dans un mortier et la rebattre en réintroduisant du salpêtre neuf. Par souci d'économie, il arrivait que la poudre soit battue très peu de temps et mélangée avec de nouvelles poudres à l'aspect plus présentable. Les fermiers les plus malhonnêtes profitaient de ce mélange pour assurer leurs livraisons de poudres neuves.
Malgré ces pratiques condamnables et souvent dénoncées, le roi se contenta tout au long de notre période de ce système d'approvisionnement confié à la ferme des poudres et salpêtres".
Notes
1 Surirey de Saint-Rémy Pierre, Mémoires d'artillerie, Paris, 3ème édition, 1745, tome II, p.310.
2 Le bois de nerprun (ou prunier noir), de la même famille que le bois de bourdaine, était également utilisé.
[1] Perrinet d'Orval, Traité des feux d'artifice pour le spectacle et pour la guerre, Berne, 1750.
[2] S.H.A.T., fonds artillerie 4w571, arrêt du conseil du roi portant obligation aux adjudicataires des ventes du bois de séparer le bois de bourdaine, le 11 janvier 1689.
[3] S.H.A.T., fonds artillerie 4w571, arrêt du conseil du roi, du 7 mai 1709.
[4] Pierre Surirey de Saint-Remy, officier d'artillerie, écrivit Les mémoires d'artillerie en 1697. Ouvrage de référence pour tout artilleur, il fut réédité à deux reprises.
[5] S.H.A.T., fonds artillerie 4w578, mémoire anonyme de 1724 sur les poudres.
[6] Siemienowicz Casimir, Grand art d'artillerie, Amsterdam, 1651, p.87.
[7] Casimir Siemienowicz fut lieutenant-général de l'artillerie du roi de Pologne.
[8] Siemienowicz Casimir, Op. cit.., p.87.
[9] Perrinet d'Orval, Traité des feux d'artifice pour le spectacle et pour la guerre, Berne, 1750.
Siemienowicz Casimir, Op. cit.., p.87.
[10] A.N., H-1 1447, mémoire de l'académie des sciences (1778).
[11] S.H.A.T., fonds artillerie 4w580, mémoire de la ferme des poudres sur le salpêtre (1758).
[12] A.N., AD VI 16, Ordonnance du Roy sur le faict et règlement des poudres et salpestres de France, le 8 octobre 1640, à Saint-Germain en Laye .
[13] A.N., AD VI 16, Statuts arrestés entre les salpestriers du Roy establis en la ville de Paris, pour la confection des salpestres de France, pour le service de Sa Majesté, le 1er janvier 1665, articles VII et VIII.
[14] S.H.A.T., fonds artillerie 4w579, lettre de Louvois aux intendants, le 30 octobre 1690, à Versailles.
[15] A.N., G-7 1296, Ordonnance de l'intendant de Bourgogne sur le règlement de la récolte du salpêtre, le 1er septembre 1690.
[16] Louis-Auguste de Bourbon, duc du Maine (1670-1736), fils légitimé de Louis XIV et de la marquise de Montespan, fit l'apprentissage des armes lors de la guerre de la ligue d'Augsbourg . Nommé grand-maître de l'artillerie en 1694, il tenta, sans grands succès, d'exercer le plus possible sa charge.
[17] S.H.A.T., fonds artillerie 4w579, Ordonnance du duc du Maine portant injonction à toutes personnes d'ouvrir ou faire ouvrir aux salpetriers les maisons, caves, selliers, bergeries, écuries, granges ; colombiers, magasins et autres lieux, pour y prendre les terres qui s'y trouveront propres à faire salpestres, le 31 juillet 1701, à Versailles .
[18] A.N., AD VI 16, Édit du Roy pour la fourniture des arsenaux et magasins de son artillerie, de deux cens cinquante milliers de salpêtre, en janvier 1634, à Saint-Germain en Laye .
[19] A.N., G-7 1297.
[20] S.H.A.T., fonds artillerie 4w580, lettre de La Chapelle, le 25 septembre 1759, à Perpignan.
[21] S.H.A.T., fonds artillerie 4w580, lettre du commissaire général des poudres et salpetres, en1759.
[22] S.H.A.T., série A-1 1157, lettre de l'intendant de Lorraine, le 20 juin 1692, à Metz.
[23] A.N., AD VI 16, Bail de la ferme générale du droit royal de la fabrique, vente et débit des poudres et salpestres de France fait par le Roy à Grandchamp, le 26 août 1690, à Versailles, article XIII, p.6.
[24] A.N., G-7 1297.
[25] A.N., AD VI 16, Bail de la ferme générale du droit royal de la fabrique, vente et débit des poudres et salpestres de France fait par le Roy à Claude Durié, le 24 juin 1684, à Versailles, p.11.
[26] S.H.A.T., fonds artillerie 4w579, Ordonnance du duc du Maine portant injonction à toutes personnes d'ouvrir ou faire ouvrir aux salpetriers les maisons, caves, selliers, bergeries, écuries, granges, colombiers, magasins et autres lieux, pour y prendre les terres qui s'y trouveront propres à faire salpestres, le 31 juillet 1701, à Versailles.
[27] A.N., G-7 1296, Arrêt du conseil du roi interdisant de s'opposer à la recherche du salpêtre, le 10 décembre 1669.
[28] A.N., G-7 1297, Déclaration royale sur la recherche du salpêtre, le 30 septembre 1677.
[29] Tous ces arrêts du conseil du roi proviennent du fonds artillerie 4w580.
[30] S.H.A.T., fonds artillerie 4w580, mémoire de la ferme des poudres sur le salpêtre (1758).
[31] Surirey de Saint-Rémy Pierre, Op. cit.., tome II, p.310. - Toutes les descriptions du raffinage du salpêtre sont tirées de cet ouvrage.
[32] A.N., AD VI 16, Bail de la ferme générale du droit royal de la fabrique, vente et débit des poudres et salpestres de France fait par le Roy à Claude Durié, le 24 juin 1684, à Versailles.
[33] Surirey de Saint-Rémy Pierre, Op. cit.., tome II, titre X.
[34] A.N., AD VI 16, arrêt du conseil du 2 mars 1700.
[35] S.H.A.T., fonds artillerie 4w662, marché passé avec le sieur Fides pour le dépérissement du sel des salpêtres dans le Languedoc et le Roussillon.
[36] Charles-Louis Auguste Fouquet de Belle-Isle (1684-1761), petit-fils du surintendant des finances de Louis XIV, fut nommé gouverneur des trois évêchés. Il devint maréchal de France en 1741. Ambassadeur exceptionnel en Allemagne, il fut rappelé en France au début de la guerre de succession d'Autriche. Il participa à la campagne du Danube et s'empara de Prague avant d'assister à l'élection impériale et d'être nommé chevalier de la toison d'or. Il dut repartir pour la Bohême afin d'assurer la retraite de l'armée prise au piège à Prague. Duc et pair en 1748, académicien en 1756, il fut nommé secrétaire d'Etat à la guerre en 1757.
[37] Bernard Forest de Belidor (1696-1761), professeur de mathématique à l'école de La Fère de 1720 à 1741, fut l'auteur de nombreux ouvrages sur l'artillerie et le génie. Il fit de nombreuses expériences sur l'effet de la poudre appliqué au tir des bouches à feu et aux mines.
[38] A.N., M 1017, lettre du comte d'Eu (1754).
[39] S.H.A.T., série A-1 3467, mémoire sur le salpêtre, de 1753.
[40] Surirey de Saint-Rémy Pierre, Op. cit.., tome II.
[41] Papacino Antoni Alessandro, chevalier d', Essai sur la poudre, Amsterdam, 1763, p.11.
[42] A.N., AD VI 16, " Bail de la ferme générale du droit royal de la fabrique, vente et débit des poudres et salpestres de France fait par le Roy à Claude Durié ", le 24 juin 1684, à Versailles, article XIV, p.13.
[43] S.H.A.T., fonds artillerie 4w590, " épreuves des poudres composées par M. Perrinet d'Orval, le 14 février 1756, à Essonne ".
[44] Surirey de Saint-Rémy Pierre, Op. cit.., 1745, tome II.
[45] Antoni Alessandro Papacino, chevalier d', Op. cit.., p.53.
[46] S.H.A.T., fonds artillerie 4w803, dossier sur le moulin de Toulouse.
[47] S.H.A.T., fonds artillerie 4w804, dossier sur le moulin de Saint-Jean d'Angély.
[48] S.H.A.T., fonds artillerie 4w804, dossier sur le moulin de Pont-de-Buis.
[49] S.H.A.T., fonds artillerie 4w803, dossier sur le moulin de Saint-Médard.
[50] A.N., AD VI 16, arrêt du conseil d'Etat du roi ordonnant aux propriétaires riverains de la rivière d'Etampes d'en réparer les berges, le 26 juin 1759, à Versailles.
[51] S.H.A.T., fonds artillerie 4w804, dossier sur la construction du moulin de Belleray, en 1732.
[52] S.H.A.T., fonds artillerie 4w804, lettre de Micault de Courbeton, en 1732.
[53] S.H.A.T., série A-1 2490, lettre de Chamillart, le 18 mai 1709.
[54] Michel-Laurent, chevalier Pelletier, commissaire provincial en 1732, participa aux sièges de Kehl (1733) et de Philisbourg (1734). Lieutenant-général d'artillerie en 1741, il suivit l'armée française en Bohème où il fut blessé. Après avoir servi sur le Rhin et en Flandre, il termina la guerre avec le grade de maréchal de camp. En 1758, il reçut le commandement de l'artillerie de l'armée de Soubise. Présent à Sundershausen et à Minden, il fut nommé lieutenant-général des armées du roi en 1760.
[55] S.H.A.T., fonds artillerie 4w804, rapport d'inspection de Pelletier, en 1759.
[56] A.N., G-7 1297, évaluation des pertes dues aux incendies pour l'année 1705.
[57] A.N., AD VI 16, "résultat du conseil du Roy contenant les conditions du bail d'Antoine de la Porte", le 24 mars 1716.
[58] A.N., AD VI 16, "arrêt du conseil du Roy du 11 juin 1748, concernant l'incendie général arrivé aux moulins à poudre d'Essonne, près Corbeil", le 5 juillet 1745.
[59] S.H.A.T., fonds artillerie 4w804, dossier concernant le moulin d'Essonne.
[60] S.H.A.T., fonds artillerie 4w803, personnel du moulin de Saint-Médard, en 1759.
[61] S.H.A.T., fonds artillerie 4w804, personnel du moulin de Maromme, en 1759.
[62] S.H.A.T., fonds artillerie 4w578, mémoire anonyme sur la ferme des poudres et salpêtres, en 1724.
[63] Ce règlement fut peut être également pris pour mettre en difficulté le fermier des poudres et pouvoir ainsi dénoncer le bail. Cf chapitre 14.
[64] S.H.A.T., fonds artillerie 4w590, règlement pour les épreuves des poudres, le 4 avril 1686, à Versailles.
[65] Pour l'épreuve, le mortier était chargée de 2 onces de poudre (61 grammes).
[66] S.H.A.T., fonds artillerie 4w590, règlement pour les épreuves des poudres, le 18 septembre 1686, à Versailles.
[67] S.H.A.T., série A-1 972, résultats des épreuves réalisées à Metz, en 1690.
[68] Jean-Baptiste de Vigny (1645-1707) fut nommé lieutenant-colonel du nouveau régiment des bombardiers (1684), puis lieutenant-général d'artillerie quatre ans plus tard. Il dirigea l'artillerie aux sièges de Mons et de Namur, mais il fut blessé devant Charleroi. Brigadier en 1690, il dirigea l'artillerie en Flandre à la veille de la guerre de succession d'Autriche et fut nommé maréchal de camp.
[69] S.H.A.T., série A-1 1401, lettre de Barbézieux à Vigny, le 8 mars 1697.
[70] Jean II Maritz (1711-1790), fils de l'inventeur de la machine à forer les canons, fut l'un des fondeurs les plus célèbres de Son temps. Il réorganisa les forges travaillant pour la Marine puis les fonderies espagnoles.
[71] Joseph-Florent de Vallière (1717-1776), succéda à son père, Jean-Florent de Vallière, comme directeur général de l'artillerie en 1747 puis fut nommé lieutenant-général des armées du Roi l'année suivante. Il s'opposa de toutes ses forces aux réformes de Gribeauval.
[72] S.H.A.T., fonds artillerie 4w590, lettre de Joseph-Florent de Vallière, le 17 décembre 1758.
[73] S.H.A.T., fonds artillerie 4w658, lettre de Jean-Florent de Vallière, le 18 mars 1730, à Paris.
[74] S.H.A.T., fonds artillerie 4w658, mémoire de d'Aboville, vers 1730.
[75] S.HA.T., fonds artillerie 4w658, mémoire de Le Cerf (1720).
[76] S.H.A.T., série A-1 1585, lettre de Monsieur de Louveciennes, le 16 mai 1702, à Gênes.
[77] S.H.A.T., série A-1 1522, lettre de d'Andigné, le 21 février 1701, à Perpignan .
[78] S.H.A.T., fonds artillerie 4w807, lettre du comte de Thomassin, le 19 janvier 1752, au Havre de Grâce.
[79] S.H.A.T., fonds artillerie 4w807, lettre du comte de Thomassin, le 19 janvier 1752, au Havre de Grâce.
[80] S.H.A.T., fonds artillerie 4w658, mémoire de Le Cerf.
[81] S.H.A.T., fonds artillerie 4w658, mémoire du sieur Thirrion (1767).
[82] S.H.A.T., fonds artillerie 4H10, lettre de Saint-Périer, le 23 janvier 1750, à Bergues.
[83] Etienne-Jean Thomassin, capitaine des ouvriers en 1731, brigadier en 1748, il devint maréchal de camp en 1762.
[84] S.H.A.T., fonds artillerie 4w807, mémoire du comte de Thomassin, le 19 janvier 1752, au Havre-de-Grâce.
[85] S.H.A.T., fonds artillerie 4w807, état des magasins à poudre en 1764.
[86] S.H.A.T., série A-1 980 ; lettre de Louvois, le 28 septembre 1690, à Marly.
[87] S.H.A.T., série A-1 1427, inventaire général d'artillerie (1697).
[88] S.H.A.T., fonds artillerie 4w807, mémoire du comte de Thomassin, le 19 janvier 1752, au Havre-de-Grâce.
[89] S.H.A.T., série A-1 1990.
[90] S.H.A.T., série A-1 1990.
[91] César Joachim, marquis de Saint-Périer (1662-1749) participa, à tous les grands sièges et à toutes les grandes batailles de la guerre de la ligue d'Augsbourg. Envoyé en Italie en 1701, il devint lieutenant-général d'artillerie deux ans plus tard. Après le repli des armées françaises de la péninsule, il rejoignit l'Espagne où la maladie du commandant de l'artillerie, M.Rigollot, lui permit de faire la preuve de ses talents. En remerciement, il succéda à La Frézelière à la tête des départements d'Alsace, du duché et du comté de Bourgogne en 1711. Devenu maréchal de camp en 1719, il quitta cette direction pour celle de Flandre, du Hainaut, de Picardie et d'Artois en 1726. Commandeur de l'ordre de Saint-Louis, il termina sa brillante carrière en Flandre.
[92] S.H.A.T., série A-1 1522, lettre de d'Andigné, le 21 février 1701, à Perpignan.
[93] S.H.A.T., série A-1 1079, lettre de Catinat, le 5 avril 1691, à Nice.
[94] S.H.A.T., fonds artillerie 4w807, état des magasins à poudre en 1764.
[95] S.H.A.T., fonds artillerie 4w807, mémoire du comte de Thomassin, le 19 janvier 1752, au Havre-de-Grâce.
[96] A titre d'exemple, le magasin à poudre de Condé, construit en 1738, avait coûté 22.000 livres tournois. S.H.A.T., fonds artillerie 4w807.
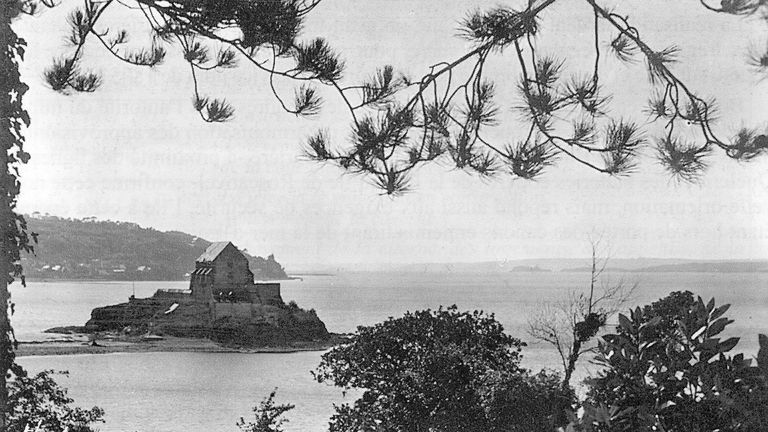

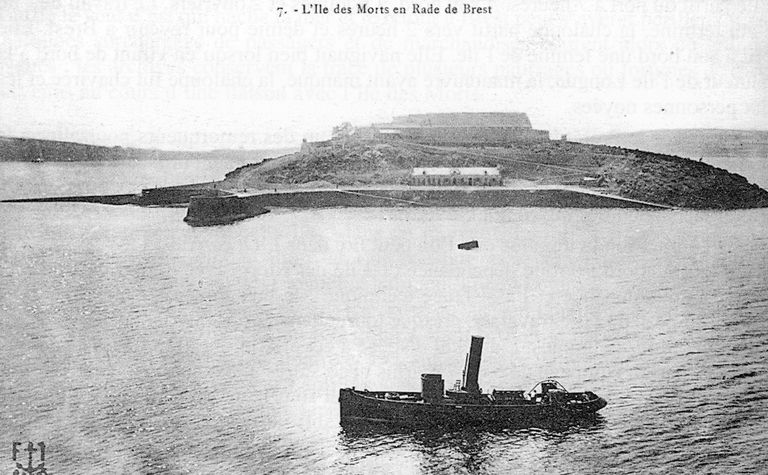


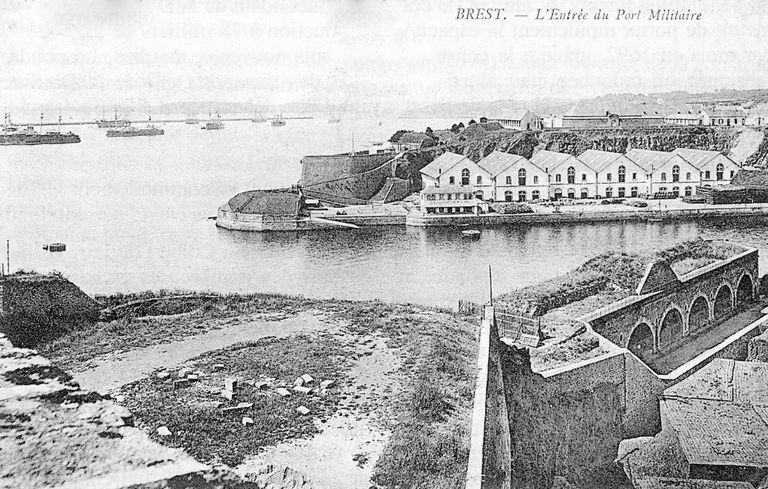






Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.